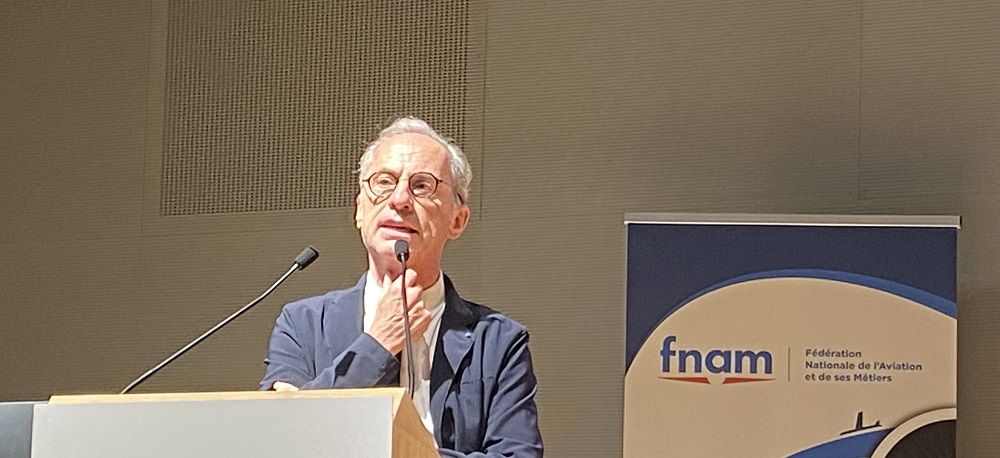Les Français montrent une connaissance limitée et souvent biaisée du transport aérien et des compagnies explique l’économiste Emmanuel Combe lors du congrès de la FNAM. Cette observation rejoint les propos de Pascal de Izaguirre. Le niveau d’information sur ce mode de transport reste globalement imparfait
Une large part de la population française surestime l’impact environnemental du transport aérien. 60% des Français surestiment l'impact de l'aérien en termes d'émissions selon un sondage IFOP.
De plus, une étude de Paul Chiambaretto montre que 90 % des répondants attribuent à l’aérien plus de 10 % des émissions mondiales de CO₂, soit trois fois plus que les estimations scientifiques les plus sérieuses. Paradoxalement, certains secteurs comme le textile, avec une empreinte entre 8 et 10 %, suscitent beaucoup moins de critiques.
Cette surévaluation trouve racine dans une faible connaissance des réalités technologiques et économiques du secteur. Peu de passagers identifient les progrès réalisés, notamment l’introduction des carburants durables (SAF) ou le renouvellement des flottes, pourtant essentiels dans la stratégie de décarbonation. Ces efforts, souvent invisibles pour les usagers, échappent à leur perception immédiate, un phénomène connu sous le nom de biais de disponibilité.
Rentabilité mal perçue et poids des idées reçues
Dans l’imaginaire collectif, les compagnies aériennes génèrent des bénéfices élevés. Or, la marge benficiaire attendue pour 2025, selon IATA, plafonne à 3,7 %, bien en deçà des secteurs comme le luxe. Ce malentendu provient d’une confusion fréquente entre prix élevé et profit important : un billet coûte cher, donc la compagnie gagne beaucoup.
Cette croyance conduit à un paradoxe : la taxation fréquente des compagnies légitime pour certains la perception d’une activité rentable, créant ainsi un cercle vicieux difficile à rompre. La situation invite à repenser la communication et l’information autour du transport aérien pour mieux ajuster perception et réalité.
Une autre idée tenace : l’aérien réservé aux élites. Pourtant, les données les plus récentes indiquent une forte démocratisation du secteur. Aujourd’hui, les employés représentent 43 % des passagers et les professions intermédiaires correspondent à 26 % d’entre-eux, selon les données INSEE. Le low cost et la libéralisation du marché ont transformé les profils des voyageurs.
Manque d’appui politique et communication déséquilibrée
Le transport aérien ne figure pas parmi les priorités de nombreux décideurs français, contrairement au ferroviaire ou à la route. Cette désaffection politique limite la diffusion d’informations objectives sur l’aérien, laissant les acteurs du secteur – compagnies, aéroports, constructeurs – seuls à porter la parole publique.
Ce déséquilibre alimente un cercle vicieux : surévaluation de la rentabilité, vision élitiste, volonté de taxer. L’absence de soutien externe favorise une taxation perçue comme légitime, nourrie par des représentations erronées.
Ambivalence écologique des consommateurs
Les Français ne rejettent pas l’avion. Seuls 12 % évoquent un sentiment de honte lié à ce mode de transport selon une étude de la Chaire Pégase 2023. La majorité le considère encore comme utile, voire indispensable. En revanche, une volonté d’usage plus raisonné se manifeste : 41 % des répondants déclarent tenter de limiter leurs trajets aériens, tandis que 36 % affirment intégrer l’impact environnemental dans leurs décisions.
Malgré cette conscience, les comportements évoluent lentement. Peu de passagers utilisent les options de compensation carbone. Chez les jeunes (15-25 ans), cette contradiction entre valeurs affichées et actes concrets persiste également : 74 % jugent l’avion polluant, mais ce critère arrive loin derrière le prix dans leurs choix.
La barrière psychologique du prix
Le prix reste le critère de choix principal pour 57 % des voyageurs révèle un sondage IFOP, insiste l’économiste. Les études d’évaluation contingente montrent une forte hétérogénéité dans la disposition à payer pour des vols plus durables. Les passagers se sentant responsables se montrent prêts à payer jusqu’à 40 € supplémentaires, contre 25 € pour les moins concernés, soit bien en dessous des surcoûts des SAF pour les compagnies. Cette disposition dépend fortement du niveau de confiance dans les engagements écologiques des compagnies.
La perception du coût l’emporte donc sur les considérations écologiques, avec des comportements d’optimisation bien ancrés : escales multiples, auto-organisation des correspondances, attrait pour les abonnements illimités.
Réconcilier attractivité touristique et transition verte
Toute restriction du transport aérien doit prendre en compte l’équilibre entre réduction d’émissions et perte d’activités économiques. Le secteur représente plus de 560 000 emplois en France et plus de 50 milliards d’euros de valeur ajoutée. Il soutient l’attractivité touristique, l’export de produits périssables, et l’internationalisation des entreprises.
Face à cela, une taxation croissante ou la suppression de certaines offres (classe affaires, lignes intérieures) risque de générer un impact négatif sur l’ensemble de la chaîne, sans garantie d’un changement significatif de comportement.
Repenser la stratégie de communication
Une communication sectorielle centrée sur les bénéfices individuels ne suffit plus. Il devient nécessaire de replacer l’aérien dans un écosystème plus large, incluant les aéroports, les constructeurs et les fournisseurs de carburants durables. Une approche pédagogique, transparente, appuyée sur des chiffres fiables peut aider à rétablir la réalité du bilan carbone.
Des campagnes inspirées du "nudge", visant à encourager une modération volontaire, comme celle d’une compagnie néerlandaise en 2019, offrent une voie prometteuse. À court terme, ces initiatives peuvent réduire le trafic, mais à long terme, elles renforcent la crédibilité environnementale des entreprises.
Eviter les pièges du greenwashing
La vigilance reste de mise. En 2024, plusieurs compagnies ont fait l’objet d’enquêtes pour allégations environnementales trompeuses. Le cadre juridique européen se renforce, notamment avec la future directive sur les allégations vertes. Comparaisons environnementales, calculs de CO₂, promesses de neutralité : chaque affirmation devra reposer sur des données vérifiables.
Une communication responsable, rigoureuse et scientifiquement fondée représente le levier le plus solide pour construire la confiance et accompagner les voyageurs vers une mobilité aérienne durable.